 Présenté sous l'étiquette forcée d'album culte, Zombie Birdhouse n'en demeure pas moins aujourd'hui, comme tant d'autres albums solo du chanteur des Stooges, un disque attachant. Foncièrement déglingué et suffisamment éloigné de ces précédentes productions new-wave, cet énième échec commercial n'a pourtant rien de la pépite cachée ou du chef d’œuvre incompris. Plus proche du diamant brut sans en avoir forcément l'éclat, le disque appartient à la catégorie rare des œuvres dont les défauts et maladresses apportent paradoxalement un capital sympathie. Une exquise œuvre malade en quelque sorte ? Oui, mais n'allons pas trop vite...
Présenté sous l'étiquette forcée d'album culte, Zombie Birdhouse n'en demeure pas moins aujourd'hui, comme tant d'autres albums solo du chanteur des Stooges, un disque attachant. Foncièrement déglingué et suffisamment éloigné de ces précédentes productions new-wave, cet énième échec commercial n'a pourtant rien de la pépite cachée ou du chef d’œuvre incompris. Plus proche du diamant brut sans en avoir forcément l'éclat, le disque appartient à la catégorie rare des œuvres dont les défauts et maladresses apportent paradoxalement un capital sympathie. Une exquise œuvre malade en quelque sorte ? Oui, mais n'allons pas trop vite...Remercié manu militari par Arista Records après trois disques (New Values en 1979, Soldier en 1980 et Party en 1981), la fin de l'année s'avérait des plus difficiles pour Iggy Pop : sans label, quasiment à la rue, et en sus une addiction à l'héroïne persistante pour vous tenir compagnie les soirs d'hiver. La tête dans le caniveau, l'iguane accumule les tares : persona non grata et has been. Or une fois encore, et en attendant le retour de l'ange blond nommé Bowie en 1983, l'histoire se répète une fois encore. Iggy croise sur son chemin un vieux fan nommé Chris Stein, tête pensante de Blondie et propriétaire depuis peu d'un label indépendant, Animal Records. Passant dès lors les premiers mois de l'année suivante à New-York, Stein lui offre toute la latitude pour enregistrer un successeur à sa précédente trilogie, et tirer ainsi un trait sur l'image qu'il ou son ancien label voulait bien donner.
A défaut de faire rugir totalement les amplis et de garder la fureur de ses jeunes années, Iggy s'applique à reprendre d'une certaine manière là où il s'était arrêté après Soldier, le tout dans une ambiance des plus barrées et borderline. Accompagné du guitariste Rob DuPrey, déjà présent sur Party, en charge ici également des synthétiseurs et autres effets, l'iguane convie, en plus de Stein à la production et à la basse, le batteur de Blondie, Clem Burke. Co-écrit avec DuPrey, Zombie Birdhouse s'écarte donc des plates-bandes normées de la new-wave pour revenir à une urgence originellement plus rock, tordue voire chaotique, somme tout en adéquation avec les moyens limités mis à leur disposition.
Produit à l'arrache, chanteur proche du délabrement, Zombie Birdhouse atout du disque mal ficelé. Toutefois comme indiqué en préambule, il ne manque pas de charme. Au contraire. Dans le sillage de certaines formations post-punk, l'iguane joue les équilibristes avec plus ou moins de réussites. Qu'importe. Mélange des genres semi-audacieux semi-foutraque, le résultat est finalement à l'image de l'Iggy Pop de ces années-ci. Entre poussées rock évidentes Run Like a Villain (1), Eat or Be Eaten et perles hypnotiques que sont Life of Work et Watching the News, l'album dévoile surtout un chanteur proche de la rupture. Chant approximatif laissant présager tout autant la consommation de substances toxiques, qu'un état mental ébranlé, à moins qu'il s'agisse d'une posture auto-caricaturale à l'image du quasi tordant The Ballad of Cookie McBride, rarement l'ancien Stooges n'aura autant paru aussi poignant ou largué (Angry Hills, Ordinary Bummer). Témoignage sonore de ses années de dérive, Zombie Birdhouse nage ainsi entre deux eaux, entre sobriété grave (Platonic) et délires alcooliques (le PILien Street Crazies). A chacun de décider s'il veut ou pas s'infliger cet essai cathartique en roue libre.
Zombie Birdhouse est en résumé le genre d'album qui vous garantit une aura culte une voire deux décennies plus tard, mais qui le moment présent, vous plombe davantage et vous laisse encore un peu plus sur le bas côté... en attendant une assurance vie prénommée David Bowie.
Titres :
01. Run Like a Villain / 02. The Villagers / 03. Angry Hills / 04. Life of Work / 05. The Ballad of Cookie McBride / 06. Ordinary Bummer / 07. Eat or Be Eaten / 08. Bulldozer / 09. Platonic / 10. The Horse Song / 11. Watching the News / 12. Street Crazies / 13. Pain & Suffering [Bonus]
(1) Seule chanson échappée de l'album présente dans le dernier best of d'Iggy : A Million in Prizes : The Anthology.



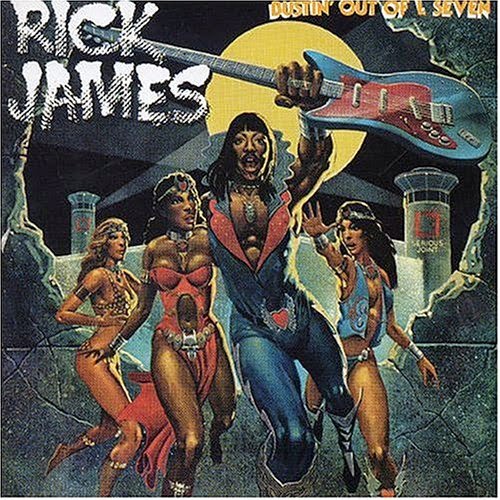


.jpg)
.jpeg)
.jpeg)


.jpg)
.jpg)



.jpeg)


















































































































